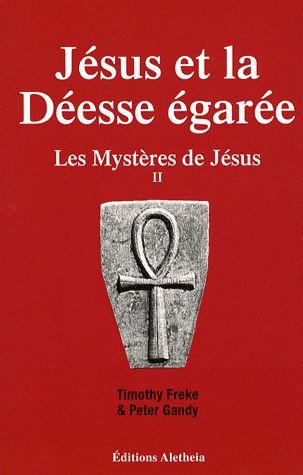mercredi 14 octobre 2015
Bouddhanar: Poutine, le monde libre
Bouddhanar: Poutine, le monde libre: Le protecteur de la sainte Russie contre la barbarie yankee et les hordes de l'OTAN. Ici (en Russie), il reste encore des racine...
dimanche 11 octobre 2015
La Nouvelle Chronologie : le blog de la déconstruction et de la démystification historique: La Gaule (Gallia en Latin) a disparu il y a 3 sièc...
La Nouvelle Chronologie : le blog de la déconstruction et de la démystification historique: La Gaule (Gallia en Latin) a disparu il y a 3 sièc...: Pour cette publication , nous allons vous démontrer que la Gaule (Gallia en latin) a disparu il y a trois siècle, et que par conséquent, l&...
samedi 10 octobre 2015
La petite chaperonne LGBT
Par Ariane Walter
Un article du blog d’Alain Benajam
Najat V-Belkacem est à
la gauche ce que Morano est à la droite : la nouvelle race des Limitated Girls
Brain Tartiflette . La brune étant plus dangereuse que la blonde puisqu’elle
s’occupe de nos enfants , la blonde régnant sur les croisiéristes Costa.
A ce sujet je parlais
avec la responsable de ma mairie, mais ce sera un autre sujet, des NAP. (Non
pas les nouveaux animaux de compagnie (NAC), mais des nouvelles activités
périscolaires.) Cela coûte 140 000 euros par an à mon bled qui rage mais est
obligé de se soumettre. Les intervenants sont payés au smic. L’autre jour, ma
petite fille ayant vomi, elle est restée à la maison. « Ce n’est pas grave, m’a
dit ma fille, c’est le jour où elle fait du tricot avec la dame de la mairie.
(J’espère que les garçons font aussi du tricot sinon je porte plainte !)
Mais passons aux
contes de fée qui, d’après Belkacem sont sexistes. Ah bon…Oui Cendrillon et
Blanche Neige font le ménage sans être aidées par les princes charmants. Le
méchant est UNE sorcière et non UN sorcier. Et l'idéal de tout ce petit monde
est de faire des enfants et de rester au château. Par-dessus le marché,
scandale total , ces histoires ne véhiculent que le couple lambda homme-femme.
Aucun prince n'est homosexuel ou Bi ou trans et aucune princesse ne veut
coucher avec Miley Cyrus. Là, pour nos égéries du Nouveau monde, c'est trop...
La suite de l’article c’est par là :
vendredi 9 octobre 2015
Comment décalcifier la glande pinéale (ou épiphyse)
Le premier objectif de la décalcification de votre glande pinéale est de vous permettre de commencer le processus de son activation et de l’éveil de votre troisième œil.
La décalcification de la glande pinéale se fait en deux temps. Le premier sert à interrompre toute calcification ultérieure de votre glande pinéale, causée par certains modes de vie ou facteurs environnementaux, par ex. le fluor, etc. La seconde étape consiste à réduire et éliminer la calcification existante et à poursuivre le développement de votre glande pinéale.
Nous passerons en revue ci-dessous les moyens d’atteindre ces deux objectifs.
L'article se trouve la:
jeudi 8 octobre 2015
Le Roi Salomon réalité ou fiction?
Par Sydney Woolf
L’article original en
anglais se trouve là :
Quiconque a écrit le
Premier Livre des Rois et le Second Livre des Chroniques ne pouvait prévoir les
possibilités de vérification offertes par l’archéologie moderne.
On pense que la cité du Roi Salomon à Jérusalem était
située sur le versant conduisant à ce
qui est maintenant la mosquée Al-Aqsa. Les archéologues israéliens ont désespérément
fouillé le site pendant des décennies et pourtant, pas l’ombre de preuve de
l’existence historique du Roi Salomon n’a été trouvée. Aucune mention de son
nom n’a été retrouvée, que ce soit sur des tablettes, des inscriptions, des
registres de taxes ou des poteries décorées.
Quiconque s’est rendu
en Egypte aura pu voir des preuves considérables [de l’existence] d’un monarque qui régna trois-cent ans avant le
Roi Salomon, le Pharaon Ramsès II. Pourtant, du Roi Salomon qui régna sur un
vaste empire et une armée (1 Rois 4, 21-26 et 1 Rois 9, 17-23, 2 Chroniques 9,
25-26), il n’y a aucune trace. Tous les peuples vassaux lui payant tribut n’ont
pas laissé la moindre trace écrite ou inscrite. Pas un des soldats de sa
conquérante armée n’a laissé la moindre épée, le moindre casque ou bouclier.
L’ouvrage en deux
volumes du Professeur Yadin "l’Art de la Guerre dans les Pays Bibliques"
(International Publishing Co. Ltd., Jerusalem 1963), est amplement illustré
d’exemples d’armures et d’armes, datant de
cette période, provenant d’autres pays, mais on cherche en vain un seul objet datant de l’empire
salomonique.
Cherchez parmi les
musées d’Israël et vous ne trouverez aucune preuve de l’empire, bien qu’il y
ait profusion d’artefacts estampillés ‘Canaan’ ou ‘Philistins’. Il est
inconcevable, si Salomon et son empire ont réellement existé, qu’on n’en trouve
aucune trace dans toutes les fouilles archéologiques partout en Israël.
Qui donc a créé cette
fiction, quand et pourquoi ? De nombreux hébreux de la captivité
babylonienne, en 586 avant notre ère, s’élevèrent à des positions de
commandement à Babylone. Bien établis et riches, ils n’avaient aucune envie de
retourner à la dure existence d’une
terre désertique et désolée. Le peuple hébreu faisait face à sa plus grande
menace : disparition totale par assimilation et leur terre avait été
envahie par les armées de tribus hostiles.
Une jeune garde
d’activistes ‘sionistes’ grossit, comme cela a été le cas récemment en ex-Union
Soviétique. Pour rendre attractive l’idée d’un retour, il fallait créer un
glorieux passé, des conquêtes militaires et un riche empire. D’où le symbole de
Salomon.
Les livres de l’Ancien
Testament, à l’exception de celui de Néhémie, ont été écrits à la même période
dans le même but – créant ainsi le canular du millénaire.
Ce n’est pas une
coïncidence que les auteurs créèrent Abraham voyageant de Babylone (Ur des
Chaldéens) à Canaan, qui est précisément l’itinéraire qu’ils convainquaient les
Hébreux d’emprunter.
L’histoire de l’Exode
est là pour montrer que même après s’être enfuit de l’esclavage, avoir enduré
quarante années pendant lesquelles leur seule nourriture leur fut donnée par
Dieu, et devant faire face à des armées puissantes, les Hébreux étaient capables
de triompher et de rétablir leur état.
Combien allait-il
devenir plus facile de se réinstaller, alors !
Un problème aurait pu
survenir en cas de parents mixtes et de leur descendance provenant de Babylone
pouvant être ostracisée lors de leur retour au pays. L’histoire de Ruth et Boaz
a été insérée pour apaiser de telles craintes.
Les Livres de l’Ancien
Testament n’ont pas pu être écrits à l’époque des Rois, avant la captivité à
Babylone, puisque la comparaison désobligeante du roi faible avec le pouvoir
d’avant de Salomon aurait dû conduire à l’exécution des auteurs. De plus, pour prévoir, longtemps avant la
captivité et les grandes colonies des Hébreux à Ur qui en résulteraient,
qu’Abraham, le père fictif de la nation, allait provenir de cet endroit, il
fallait que les auteurs soient
remarquablement doués pour prédire l’avenir.
Il n’y a que trois
possibilités concernant l’écriture de la Torah et de ses livres associés :
1. Ils ont été écrits par Dieu. 2 Ils ont été écrits par des hommes inspirés
par Dieu. 3. Ils ont été écrits par des hommes. S’ils avaient été écrits ou
inspirés par le Dieu omniscient, il y aurait eu des années-lumière, des
galaxies, des supernovas, des trous noirs et non pas les contes de fées de la
Genèse.
Les auteurs ont créé
un Dieu omnipotent exigeant obéissance mais aussi attentif aux désirs et
émotions de chaque être humain. C’est là l’objet de l’histoire d’Abraham et
d’Isaac. Un tel Dieu a été attrayant depuis des milliers d’années pour des
humains effrayés par un univers solitaire, froid et vide.
La coutume, pour les
petites nations captives, était d’être assimilées aux populations de leurs
vainqueurs et de disparaître, à l’exemple des Philistins. En écrivant les
livres de l’Ancien Testament, leurs auteurs ont convaincu un nombre suffisant
d’Hébreux pour empêcher que cela leur arrive. Bien qu’à l’origine ils fussent
destinés à leurs compatriotes contemporains, ces livres, fruit de certains Hébreux
géniaux, ont influencé les croyances pendant des milliers d’années après leur
époque. Ils ont aussi permis de préserver une communauté influente hébraïque à
Babylone.
Il y a de nombreuses
histoires d’intérêt humain, des romances ou des histoires à connotation
sexuelle dans les livres de ces auteurs, qui, évidemment, aimaient à écrire.
Prouver ou réfuter sont deux tâches également impossibles puisqu’il n’existe
pas de documents originaux qui s’y rattachent. Il est possible qu’ils aient été
détruits délibérément dans le but d’accroître la croyance en Dieu.
Des millions de gens
sont morts au Moyen-Orient et en Occident, en s’entretuant pour une fiction.
Jésus et la Déesse - Les enseignements secrets des premiers chrétiens - par Timothy Freke et Peter Gandy
Ceci est ma traduction d’un article paru en anglais en 2003 sur
le site de Graham Hancock.
Merci à Sabine Schäublin pour sa relecture et ses corrections.
Lien vers l’article original :
Timothy Freke, licencié en philosophie, est un expert en spiritualité du
monde, et auteur de plus de vingt ouvrages. Peter Gandy a une maîtrise de
civilisation classique. Pour plus d’information sur ces auteurs, leurs
ouvrages, cours et séminaires, veuillez consulter le site :
Si l’idée d’une secte ayant
fabriqué l’histoire de Jésus peut nous sembler étrange, de nos jours, c’est
parce que nous ne voyons plus les mythes de la même façon que nos ancêtres.
Pour nous, les mythes sont des fariboles sans intérêt, alors que les anciens
les considéraient comme de profondes allégories renfermant des enseignements
mystiques codés.
Épiphane, par exemple,
nous décrit les chrétiens gnostiques comme usant d’ ‘‘interprétation allégorique’’
pour ‘‘recomposer’’ à leur guise les écrits juifs et la ‘‘mythologie épique grecque’’, qui sont
précisément les deux sources utilisées pour la création du mythe de Jésus1.
Les Mystères Internes
Dans notre dernier
livre, Jésus et la Déesse Égarée2,
nous explorons comment l’histoire de Jésus n’était qu’une partie d’un plus
grand corpus de mythologie chrétienne qui combinait des motifs mythologiques
juifs et païens. Les chrétiens originaux traitaient l’histoire de Jésus comme
une allégorie à utiliser pour présenter aux débutants la voie spirituelle. Pour
ceux désireux d’aller plus loin, plus profond que les ‘‘mystères externes’’, qui
étaient seulement ‘‘pour les masses’’, il y avait les enseignements secrets ou
‘‘mystères internes’’. Il s’agissait des ‘‘traditions secrètes de la vraie
Gnose’’, qui d’après le Père de l’Église Clément d’Alexandrie, étaient
transmises ‘‘à un petit nombre par une lignée de maîtres’’. Ceux initiés aux
mystères internes découvraient que le christianisme n’était pas seulement la
mort et la résurrection du Fils de Dieu. On leur racontait aussi un autre mythe,
dont peu de chrétiens actuels ont seulement ne serait-ce qu’entendu parler.
L’histoire de l’amour de Jésus. La Fille de la Déesse, perdue et rachetée.
Les chrétiens des
premiers temps vénéraient le divin non seulement comme Dieu le Père mais comme
Sophia, la Sage Déesse. Paul nous dit, dans sa première Épître aux Corinthiens,
que ‘‘parmi les initiés, nous parlons de Sophia’’, car c’est ‘‘le secret de
Sophia ’’ qui est ‘‘enseigné dans nos mystères ’’. Lorsque les initiés des
mystères internes du christianisme prenaient part à la Sainte Communion, c’est
la passion et les souffrances de Sophia qu’ils se remémoraient. Parmi les premiers
chrétiens, prêtres et prêtresses offraient aux initiés du vin comme symbole de ‘‘son
sang’’. La prière suivante était offerte : ‘‘Puisse Sophia emplir
l’intérieur de ton être et accroitre sa Gnose en toi ’’. C’est à elle qu’ils
adressaient leurs prières:
‘Viens, Ô, Secrète Mère ; viens, toi qui te
manifestes par tes œuvres et qui donnes la joie et le repos à ceux qui te sont
attachés. Viens et prend part à cette Eucharistie que nous accomplissons en ton
nom, et à cette agape pour laquelle nous nous sommes réunis à ton invitation.’
Dans les mystères
internes secrets des chrétiens des origines, l’histoire de Jésus était placée
dans son contexte légitime à la fin d’un cycle de mythes chrétiens, commençant
avec l’ineffable Mystère, manifesté en tant que Père et Mère primordiaux, et trouvant son apogée dans l’union mystique
de Jésus et Sophia. Il fut alors révélé que tous ces mythes étaient des
allégories d’initiation spirituelle – histoires symboliques contenant une
profonde philosophie, ayant le pouvoir de transformer un chrétien en un Christ.
Le mythe de Sophia
Il existe de
nombreuses versions du mythe chrétien de Sophia, mais en essence, l’histoire
est celle de sa chute de la maison de son Père dans le monde, où elle se perd,
de sa quête d’amour qui la conduit à tous les mauvais endroits, de ses nombreux
faux amants qui la maltraitent et de la
prostitution dans laquelle elle finit par sombrer. A la suite de son repentir
et de ses appels à l’aide, son Père envoie à son secours son frère/amant
Christ. Sophia représente l’âme de chaque initié, et le mythe une allégorie de
la descente de l’âme, de son incarnation dans un corps humain, où elle se perd
dans le monde, et de sa libération spirituelle, par la suite, au contact du
Christ intérieur, représentant la Conscience de Dieu, au cœur de tous les
êtres.
Les chrétiens
représentent souvent Sophia sous deux aspects. La Sophia la plus élevée est
symbolisée par une mère vierge et représente la pureté originelle de l’âme, à
partir de laquelle notre corps se matérialise de lui-même. La Sophia de la
déchéance est symbolisée par une prostituée qui est rachetée, et qui représente
l’âme descendue et incarnée, perdue dans le monde et son besoin d’illumination
spirituelle.
Le mythe chrétien du
Dieu-homme Jésus ne peut être convenablement appréhendé qu’en relation au mythe
de sa contrepartie, la Déesse chrétienne Sophia. Dans le mythe de Sophia, la
Déesse constitue la figure centrale, alors que son frère/amant n’est qu’un
personnage secondaire. Dans le mythe de Jésus, c’est l’inverse. Le Dieu-homme
est le personnage central. Pourtant, le mythe de la Déesse perdue constitue
bien un contexte d’importance sous-jacent
à l’histoire de Jésus, chose qui aurait été évidente pour les chrétiens initiés,
connaissant les deux allégories. Dans les Evangiles, les deux Maries
représentent les deux Sophias, celle de l’élévation et celle de la bassesse.
Elles portent toutes deux le même nom pour accentuer le fait qu’elles sont deux
aspects mythologiques d’un même personnage. Comme dans le mythe de Sophia, la
première Marie est une mère vierge, comme Sophia avec le Père, et la seconde,
une amante, une prostituée rachetée par
Jésus, comme la Sophia perdue dans le monde ici-bas.
Comme son
fils/frère/amant Jésus, la Déesse chrétienne est une figure syncrétique créée à
partir de deux sources, juive et païenne. Les chrétiens gnostiques eux-mêmes,
retracent l’origine du mythe de leur Sophia à des textes juifs, comme la Genèse,
Jérémie, Ézéchiel, les Proverbes et à divers mythes païens. Par exemple, et
principalement, l’histoire de la Déesse déchue et rachetée, souvent dépeinte
sous les deux aspects d’une amante vierge et d’une prostituée, qu’on peut
trouver dans les mythes païens d’Aphrodite, d’Hélène, d’Éros, de Psyché et,
celui encore plus connu de Déméter. Tous ces mythes, nous disent les auteurs
païens, sont des allégories de la descente de l’âme, son incarnation et
son rachat ultérieur.
Les personnages de
Déméter et Perséphone furent élaborés par les Grecs à partir de l’ancienne
mythologie égyptienne. Le philosophe païen Porphyre nous enseigne que la déesse
égyptienne Isis est l’équivalente des deux déesses Déméter et Perséphone. De la
même façon que le mythe égyptien de la mort et résurrection du Dieu-homme
Osiris est la plus ancienne source du mythe de Jésus, le mythe d’Isis constitue
la source la plus ancienne du mythe chrétien de Sophia, la Déesse perdue et
rachetée.
Sophia, dont le nom
signifie ‘‘Sagesse’’, était la Déesse des philosophes païens depuis des
siècles. De fait, le terme ‘‘philosophe’’, utilisé en premier par Pythagore,
signifie ‘‘qui aime Sophia’’. Bien qu’ils soient, de nos jours, souvent
dépeints comme d’ennuyeux universitaires, ces brillants intellectuels étaient
en réalité de mystiques dévots de la Déesse. Sophia était également une figure
mythique de premier plan pour les philosophes gnostiques juifs, tel Philon le
Pythagoréen (Philon d’Alexandrie).
La Déesse Juive
Bien que rejetée plus
tard par les juifs majoritaires, la tradition d’une déesse juive avait toujours
existé. A une certaine époque, les Israélites vénéraient la Déesse Ashérah, en
tant que consort du Dieu juif Jéhovah. Au 5ème siècle avant notre ère, on la
connaissait en tant que Anat Jahu. Dans des écrits composés entre les 4ème et
premier siècles avant notre ère, tels que les Proverbes, la Sagesse de Salomon
et la Sophia de Jésus fils de Sirach, elle devient la compagne de Dieu et
co-créatrice Sophia. La Sophia juive est l’amante et l’inspiratrice de la bonté
et de la sagesse. Elle est ‘‘une initiée aux Mystères de la Gnose de Dieu’’,
qui enseigne à ses suivants comment devenir ‘‘amis de Dieu’’ – le nom
omniprésent utilisé par païens, juifs et gnostiques chrétiens. La Sophia de
Salomon nous assure :
‘‘Sophia brille d’un éclat qui ne diminue jamais. Elle
est immédiatement discernée par ceux qui l’aiment et elle est trouvée par ceux
qui la cherchent. Elle est prompte à se faire connaitre de ceux qui désirent sa
Gnose.’’
La littérature juive
traitant de la Sophia parle d’un mythique ‘‘Homme de Bien’’ – personne en
particulier – qui est l’envoyé de la Déesse sur terre. Moïse fut dépeint comme
un tel envoyé. D’après le mythe de l’Exode, lorsqu’il transmet son autorité à
Joshua (Grec : Jésus), il reçoit également ‘‘l’esprit de Sophia’’. Pour
les gnostiques chrétiens, leur héro mythique Joshua/ Jésus
est pareillement l’envoyé de Sophia venu pour révéler sa Sagesse conduisant à
la Gnose. D’où le ‘‘secret’’ proclamé par Paul dans son Épître aux
Colossiens : ‘‘Christ dans lequel sont cachés les trésors de Sophia et de
la Gnose’’.
Dans la littérature
juive traitant de la Sophia, ‘‘l’homme de bien’’ est persécuté par son propre
peuple pour avoir prêché la sagesse de Sophia et condamné à une ‘‘mort infâmante’’.
Mais il est, par la suite, vengé, et confronte ses persécuteurs en les
jugeant dans les cieux, où il est un des ‘‘Fils de Dieu’’. Entre les mains des
gnostiques chrétiens, cet ‘‘Homme de
Bien’’ devient Jésus le ‘‘Fils de Dieu’’, qui vient, disent-ils, ‘‘afin que
Sophia soit proclamée’’. Assassiné par les siens, fourvoyés, mais vengé par sa
résurrection aux cieux, où il trône comme juge divin.
A notre avis, la
preuve est clairement faite que le christianisme était, à l’origine, la
synthèse d’une philosophie spirituelle et d’une mythologie allégorique juives
et païennes préexistantes, et qu’au centre de cette tradition, était le mythe
de la Déesse Sophia. L’éradication, par l’Église Romaine patriarcale, de la
Déesse chrétienne nous a rendu, nous tous, orphelins de mère. On a refusé aux
femmes un rapport de sympathie avec le Divin Féminin. On a refusé aux hommes
une histoire d’amour avec la face féminine de la Déité. La spiritualité a pris
part au combat qui sépare les sexes, quand elle devrait être le sanctuaire de
la communion éternelle. Pourtant, les premiers chrétiens pratiquaient la
‘‘spiritualité associée’’.
Ils étaient connus
pour la même valeur qu’ils accordaient à l’homme comme à la femme, en tant
qu’expressions du Dieu et de la Déesse. Ils voyaient la division des sexes
comme une corrélation de la polarité primaire qui est à la base de la vie. Une
dualité, qui, devenue Unité, comme dans l’acte physique d’amour, apporte la
félicité de l’union mystique qu’ils appelaient ‘‘Gnose’’.
Notes de traduction :
1 Le mythe de Jésus est une création très complexe. L’une des sources –
très souvent occultée – et mentionnée plus bas dans le texte, est égyptienne. A
ce sujet, Jacques Grimault ne mâche pas ses mots lorsqu’il déclare dans son
entretien à MetaTV : « …Le christianisme prend ses sources en
Egypte et pas ailleurs. Quand on dit judéo-christianisme c’est de la foutaise… »
2 Paru en 2008 en français
Quelques liens utiles en
français pour en apprendre plus:
Sur le livre Jésus et la Déesse Égarée :
Sur l’auteur Timothy Freke :
sur Épiphane de Salamine :
sur Clément d’Alexandrie :
sur la Première Épître de Paul aux Corinthiens :
sur la Genèse :
sur le Livre de Jérémie :
sur le Livre d’Ézéchiel :
sur le Livre des Proverbes :
sur Aphrodite :
sur Hélène :
sur Éros :
sur Psyché :
sur Déméter :
sur Perséphone :
sur le rapport entre Isis, Déméter et Perséphone :
sur les Mystères d’Eleusis :
sur Porphyre :
sur la Sagesse de Salomon
sur Anat mère des Dieux :
sur Yahvé et Ashérah :
sur la Déesse Ashérah :
sur les Trinités indo-européennes
sur la Sophia de Jésus fils de Sirach :
Si vous voulez en savoir encore davantage sur le sujet, je ne saurais trop
vous recommander de faire vos propres recherches dans toutes les langues que
vous connaissez !
Nombreux rapports de la réforme bouddhique avec le catholicisme
Extraits de l’ouvrage Souvenirs
d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 1845 et
1846.
par le Père Évariste
HUC (1813-1860)
Chapitre 3 Le Thibet
Nombreux rapports de la réforme bouddhique
avec le catholicisme.
pp 520-522
Pour peu qu’on examine
les réformes et les innovations introduites par Tsong-Kaba dans le culte
lamaïque, on ne peut s’empêcher d’être frappé de leur rapport avec le
catholicisme. La crosse, la mitre, la dalmatique, la chape ou pluvial, que les
grands lamas portent en voyage ou lorsqu’ils font quelque cérémonie hors du
temple ; l’office à deux chœurs, la psalmodie, les exorcismes, l’encensoir à
cinq chaînes, et pouvant s’ouvrir et se fermer à volonté ; les bénédictions
données par les lamas en étendant la main droite sur la tête des fidèles ; le
chapelet, le célibat ecclésiastique, les retraites spirituelles, le culte des
saints, le jeûne, les processions, les litanies, l’eau bénite : voilà autant de
rapports que les bouddhistes ont avec nous. Maintenant, peut-on dire que ces
rapports sont d’origine chrétienne ? Nous le pensons ainsi ; quoique nous
n’ayons trouvé ni dans les traditions ni dans les monuments du pays aucune
preuve de cet emprunt, il est permis néanmoins d’établir des conjectures qui
portent tous les caractères de la plus haute probabilité.
On sait qu’au XIVe
siècle, du temps de la domination des empereurs mongols, il existait de
fréquentes relations entre les Européens et les peuples de la haute Asie. Nous
avons déjà parlé, dans la première partie de notre voyage, des ambassades
célèbres que les conquérants tartares envoyèrent à Rome, en France et en
Angleterre. Nul doute que ces barbares durent être frappés de la pompe et de
l’éclat des cérémonies du culte catholique, et qu’ils en emportèrent dans leur
désert des souvenirs ineffaçables. D’autre part, on sait aussi qu’à la même
époque, des religieux de différents ordres entreprirent des courses lointaines,
pour introduire le christianisme dans la Tartarie ; ils durent pénétrer en même
temps dans le Thibet, chez les Si-fan et les Mongols de la mer Bleue. Jean de
Montcorvin, archevêque de Pékin, avait déjà organisé un chœur, où de nombreux
religieux mongols s’exerçaient tous les jours à la récitation des psaumes et
aux cérémonies catholiques. Maintenant, si on fait attention que Tsong-Kaba
vivait précisément à la même époque où la religion chrétienne s’introduisait
dans l’Asie centrale, on ne sera pas étonné de trouver dans la réforme
bouddhique des rapports aussi frappants avec le christianisme.
Inscription à :
Articles (Atom)